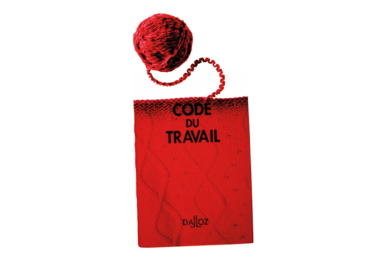VSS : « Prendre en charge les victimes est une question de moyens et de volonté politique »
Comment la justice française a-t-elle fait face au mouvement #MeToo ? Réussit-elle à répondre aux attentes des victimes ? C’est à ces questions que Marine Turchi, journaliste à Mediapart, a essayé de répondre, en 2021, dans son livre Faute de preuves.
dans l’hebdo N° 1809-1810 Acheter ce numéro

© Valerie Dubois / Hans Lucas / AFP
Dans le même dossier…
VSS : quand l’agresseur est un de vos proches Survivre aux violences sexistes et sexuelles VSS : la voie étroite de la justice internationale VSS : au procès, ne pas être victime une seconde fois« La justice nous ignore, donc on ignore la justice. » Ce sont ces mots de l’actrice Adèle Haenel qui ont convaincu Marine Turchi, journaliste à Mediapart, pionnière dans l’investigation sur les violences sexistes et sexuelles, de se pencher sur le rôle de la justice dans leur prise en charge. Et le constat est amer. Sept ans après #MeToo, les avancées restent encore bien trop insuffisantes.
Faute de preuves, de Marine Turchi, Seuil, 2021.
Quelle différence observez-vous entre les prises de parole d’Adèle Haenel, en 2020, et de Judith Godrèche, quatre ans plus tard ?
Marine Turchi : Quand Adèle Haenel prend la parole, on est dans un moment marqué par la tribune de Catherine Deneuve [qui parle de « droit d’importuner » N.D.L.R.], dans une sorte de retour de bâton par rapport à la parole des victimes de violences sexuelles. La parole de Judith Godrèche, elle, arrive après celles de Valentine Monnier, Vanessa Springora, Camille Kouchner, etc. Donc, forcément, elles ne disent pas la même chose. Le message d’Adèle Haenel, c’est : « Reconnaissez nos récits ». Judith Godrèche, elle, dénonce le silence et dit : « Maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? »
À cette seconde question, c’est de la justice, presque instinctivement, qu’on attend qu’elle joue ce rôle. Y arrive-t-elle aujourd’hui ?
Au vu des chiffres élevés de classement sans suite, non. Le ministère de la Justice ne cherche d’ailleurs pas à obtenir des statistiques affinées en matière de violences sexuelles. Dans mon livre, je raconte un épisode marquant : quand, en 2021, je vais voir la porte-parole du ministère – face à laquelle j’ai dû batailler pour obtenir un rendez-vous –, elle m’avoue qu’ils ne disposent pas de chiffres plus récents que ceux de 2016 !
Audrey, 38 ans, enseignante
Fin 2019. Je reçois des SMS malveillants d’un présumé inconnu. Des propositions sexuelles, du harcèlement, du dénigrement. Je vais déposer plainte à la gendarmerie, qui incrimine d’emblée mon conjoint, craignant qu’il ne devienne violent. Les gendarmes proposent de m’appeler plusieurs fois par jour. Je leur raconte les tromperies et frasques de mon conjoint, mais ils ne repèrent pas l’emprise qu’il a sur moi.
Les humiliations, l’indifférence, les pénétrations et éjaculations pendant mon sommeil sont des actes coutumiers. Les gendarmes ont relevé les SMS malveillants, mais n’ont pas été capables d’identifier les abus et le harcèlement psychologique subis au quotidien. Je me sens seule face au danger.
Quelques jours plus tard, vers 3 heures du matin, mon conjoint me réveille. Je comprends qu’il est bien l’auteur des SMS. Il m’attrape le bras, j’arrive à appeler les gendarmes. Ils arrivent. Ils ont peur de me laisser avec lui. Il est convoqué dès le lendemain.
Sous emprise, je m’inquiète pour lui, pour notre famille. Pas pour moi. Je maintiens difficilement ma plainte. Mais il sort avec un simple rappel à la loi. Je me sens trahie ! À l’assistante sociale qui me demande si je veux rester avec lui, je dis « oui ». Elle ne me pose aucune question.
Il m’a fallu six mois de plus dans cet enfer pour comprendre qu’il fallait fuir ce bourreau. Seule, j’ai surmonté cette épreuve sous les regards aimants mais démunis de mes parents et amies. Après un séjour à l’hôpital, un déménagement, un burn-out et trois ans de thérapie, la vraie Audrey a enfin réussi à refaire surface.
Après, il faut reconnaître qu’une partie du monde judiciaire – qui reste minoritaire – a pris conscience des dysfonctionnements. Certaines figures, comme Gwenola Joly-Coz, première présidente de la cour d’appel de Poitiers, disent qu’il faut entendre les interpellations d’Adèle Haenel et de celles qui ont suivi. On voit aussi que, ces dernières années, l’accueil de la parole dans les commissariats s’est amélioré et que davantage de policiers sont formés. Avec une limite : on peut former tous les policiers et magistrats que l’on veut, on ne détricotera pas une idéologie et des stéréotypes profondément ancrés chez certains. Enfin, il y a surtout un manque de moyens criant. Quand on compare à d’autres pays, on est très en deçà.
Dans votre livre, vous évoquez des structures, comme la Maison des femmes à Saint-Denis, qui fonctionnent bien. Pourquoi ne pas étendre ce genre de lieux ?
Cela fait longtemps qu’on observe que le problème, c’est que tout n’est pas fait au même endroit. Une personne qui veut porter plainte pour un viol récent doit se rendre au commissariat, puis à l’unité médico-judiciaire à l’hôpital pour faire les constatations. Tout cela est très violent. La Maison des femmes, à Saint-Denis, en signant un partenariat avec le parquet de Bobigny en 2021, a justement réussi à rassembler toutes ces étapes. D’abord on réalise les prélèvements et examens médicaux pour qu’elles puissent se doucher, puis, si elles le souhaitent, un policier vient prendre leur plainte et un suivi psychologique est possible. Cela rend cette épreuve plus humaine et bienveillante. Mais ce modèle fonctionne grâce à des mécènes privés qui complètent les subventions publiques. Donc c’est à la fois une question de moyens et de volonté politique.
La part des classements sans suite dans les affaires de violences sexistes et sexuelles est très élevée. Comment l’expliquer ?
C’est à la fois lié à la difficulté de trouver les preuves, au manque de moyens et de temps, mais aussi de volonté politique. Un épisode l’illustre bien : en 2018, des chiffres accablants ont été rendus publics par le ministère de la Justice. Ils montrent qu’en dix ans (2005-2016), les condamnations pour viol ont baissé de 44 % alors que le nombre de plaintes a augmenté de 40 %. En interne, ces chiffres ont affolé. Certains ont proposé d’éplucher des dossiers classés pour comprendre, avec le ministère de l’Intérieur. Mais cette volonté d’introspection s’est heurtée à de fortes résistances. Après deux réunions, le projet a capoté !
Depuis MeToo, les plaintes pour viol ne cessent d’augmenter, d’année en année. N’y a-t-il pas là une forme de désajustement entre ce que la société considère comme un viol et ce que la justice pénale prend en compte ?
Le seuil de tolérance des femmes à l’égard de ces violences a baissé, et c’est heureux. La conséquence, c’est que des dossiers pénalement moins graves ou moins évidents arrivent dans les mains des magistrats. Les viols conjugaux sont un bon exemple : avant, beaucoup de victimes ne les dénonçaient pas ; aujourd’hui, ils sont davantage judiciarisés, mais ils sont davantage classés que d’autres, car moins investigués, au motif que ce serait des dossiers « parole contre parole ». Pourtant, les affaires de violences sexuelles sont plutôt des paroles au pluriel contre parole au singulier. Mais encore faut-il aller chercher ces paroles.
Des victimes veulent une reconnaissance de la gravité des actes qu’elles ont vécus sans pour autant que les agresseurs aillent en prison. Comment expliquer cette frilosité des pouvoirs publics sur le sujet ?
Il y a un paradoxe. D’un côté, le viol est l’un des crimes les plus graves sur l’échelle pénale, il fait l’objet d’une forte réprobation sociale. De l’autre, il fait l’objet de classements massifs alors même que, dans neuf cas sur dix, l’auteur est identifié. Au Canada, on réfléchit à l’idée d’une peine moins importante pour les viols, en partant du principe que, lorsque l’auteur encourt vingt ans de prison, cela rend la révélation des faits comme les aveux plus difficiles. En France, ce débat n’émerge pas, en partie parce qu’on prend moins en compte les attentes des victimes. Or loin de constituer un bloc uniforme, ces attentes sont différentes. Certaines veulent que l’agresseur aille en prison ; d’autres attentent surtout des aveux qui pourraient être réparateurs.
Comme l’ont soulevé la sociologue Véronique Le Goaziou et le magistrat Antoine Garapon, on n’explore pas assez d’autres voies, comme un « plaider coupable » en contrepartie d’une garantie de ne pas aller en prison. Quant à la justice restaurative, elle est surtout expérimentée de manière locale, à l’initiative de tel ou tel magistrat.
Plusieurs voix ont alerté sur l’impasse du tout-carcéral. L’avocate Anne Bouillon, figure de la défense des femmes victimes de violences, estime qu’il faut plutôt réfléchir à des alternatives à la plainte et à la justice punitive, car avec 80 000 viols par an, on n’y arrivera pas. Les violences sexuelles ne sont pas seulement l’affaire de la justice. Des politiques publiques fortes en matière de santé, d’éducation et de prévention sont également nécessaires.
Marie-Thérèse, 55 ans
Avec ma sœur jumelle, nous avons été placées en famille d’accueil. De 6 à 9 ans, les deux frères de cette famille nous ont violées plusieurs fois par semaine.
L’organisme de placement est venu nous voir une fois, puis plus jamais. Ils nous ont laissées en danger. J’ai parlé pour la première fois quand j’avais 21 ans. En 1990, j’ai été convoquée par les flics quand nous avons porté plainte avec ma sœur. Mais je ne suis jamais passée au tribunal. Je voulais qu’on m’entende, pour pouvoir dire tout ce que nous avons enduré dans cette famille d’accueil. Mais je n’ai pas pu à cause d’un avocat qui s’est débarrassé de moi et de mon dossier. Nous sommes victimes d’être pauvres et de pas pouvoir nous défendre. Cet avocat m’a fait rater la confrontation en me disant que les agresseurs ne s’étaient pas présentés au tribunal pour les faits de viol, alors qu’ils étaient venus.
L’avocat a fait des actes sans me concerter. Il a demandé une réparation pour sévices sexuels alors qu’il a lui-même dit que j’avais subi des viols. J’ai eu 5 000 francs de dommages et intérêts de la famille d’accueil. Il a osé me dire : « C’est une jolie somme. » Les 5 000 francs, à leurs yeux, c’est comme s’il y avait eu justice. Moi, je ne voulais pas d’argent. Je voulais faire entendre la souffrance que j’ai en moi. Et que toute la famille soit punie.
Ça fait trente-quatre ans que je me bats. J’avais 6 ans, j’en ai 55 et je pleure toujours autant. Je suis sous anxiolytiques, j’ai des angoisses et une dépression. J’ai écrit à Belloubet, à Darmanin, à Attal, à tout le monde. Aujourd’hui, il y a prescription, mais nous avions des droits et je les réclame.
Face à ce taux important de classements sans suite, de nombreuses victimes ne se sentent pas crues par la justice et se tournent vers les médias pour être entendues. Vous êtes parmi les journalistes pionnières à avoir fait de ce sujet un champ d’investigation, le considérant d’intérêt public et non comme de la « vie privée ». Pourquoi ?
Les médias font un travail différent de la justice, ils ne sont ni policiers, ni procureurs, ils informent sur un sujet d’intérêt public. Ils sont perçus, a contrario de la justice, comme une voie rapide, plus facile. En réalité, l’enquête journalistique n’est pas un long fleuve tranquille pour les victimes. Car s’il y a d’abord le temps de l’écoute, ensuite il y a celui de la vérification. On va leur poser énormément de questions, qui ne sont pas toujours agréables, et on ne mettra jamais sous le tapis des éléments à décharge. On vérifie tout : les dates, les lieux, les protagonistes qui sont cités dans leurs récits. On leur demande des SMS, des documents, on questionne les témoins, les confidents. Et à la fin, on contacte le mis en cause.
C’est une phase à part entière de l’enquête, qui ne se matérialise pas par un simple coup de téléphone vingt-quatre heures avant la publication. On demande un entretien et, s’il est refusé, on envoie des questions extrêmement détaillées. Qu’on donne la parole au mis en cause n’est pas toujours compris des victimes. Mais on leur explique tout ce qu’on va faire, étape par étape. Et notamment que ce travail solide permet de sortir du « parole contre parole ». C’est peut-être ce qui manque, parfois, à l’institution judiciaire : le temps d’expliquer.
Quand vous nous racontez votre manière d’enquêter, on se dit que ce n’est pas si loin de ce que pourrait faire un policier ou un juge d’instruction. Ne serait-il pas bénéfique qu’eux s’inspirent, un peu, de votre méthodologie ?
La justice enquête sur les faits dont elle est saisie. On l’a vu dans de nombreuses affaires (Gérard Depardieu, Patrick Poivre d’Arvor, etc.), elle n’a au départ qu’une plainte en main, et ces dossiers sont donc vite réduits à un « parole contre parole », et classés. Il faut attendre que la presse révèle d’autres témoignages pour que ces affaires prennent une tout autre tournure. Est-ce le rôle de la justice de chercher d’autres victimes ? Aujourd’hui, elle n’en a de toute façon pas les moyens, et cela explique aussi le taux de classement. Pour constituer le fameux « faisceau d’indices graves et concordants », il faudrait que les enquêteurs aient davantage de temps pour mener des enquêtes d’environnement et remonter sur plusieurs années. Ce travail est réalisé pour les tueurs en série, plus rarement pour les violeurs, alors qu’on sait que ce sont souvent des agresseurs en série.
La présomption d’innocence, comme la prescription, n’empêche ni la tribune, ni la parole, ni le hashtag.
Comment enquêter sur ces sujets tout en respectant le principe de la présomption d’innoncence ?
Il faut rappeler ce qu’est la présomption d’innocence, et ce qu’elle n’est pas. C’est une règle pénale fondamentale : quand une enquête pénale est ouverte, le mis en cause est présumé innocent tant qu’il n’est pas condamné. Mais aujourd’hui ce principe est dévoyé. Quand je révèle l’affaire Adèle Haenel, il n’y a pas d’enquête judiciaire ouverte, et pourtant, tout de suite, on crie à l’atteinte à la présomption d’innocence. Aujourd’hui, cette règle est utilisée comme un argument bâillon, une manière de dire : « Taisez-vous ! »
Pourtant, la présomption d’innocence, comme la prescription, n’empêche ni la tribune, ni la parole, ni le hashtag, ni la sortie de la salle des Césars. Cela constaté, les journalistes ne sont pas au-dessus des lois. Si le mis en cause estime qu’il est diffamé ou que sa présomption d’innocence est atteinte, il peut les attaquer en justice. Les accusations de violences sexuelles sont graves et portent forcément atteinte à la réputation. Cela nous rappelle notre immense responsabilité et nous oblige à travailler sérieusement.
Pour aller plus loin…

Militants basques de Louhossoa : « coupables » d’avoir désarmé ETA… mais dispensés de peine

VSS : la voie étroite de la justice internationale

VSS : au procès, ne pas être victime une seconde fois