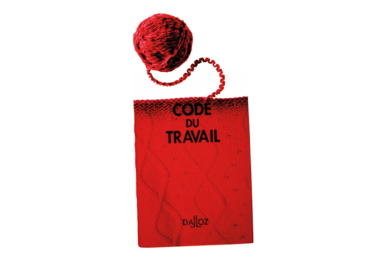À la maison, à l’école, en ligne ou dans la rue : les violences LGBTIphobes sont partout
Deux rapports, l’un de SOS Homophobie, l’autre de l’Observatoire LGBTI+ de la Fondation Jean Jaurès révèlent, en cette Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, l’insécurité dans laquelle vivent les personnes LGBT et ce, dès leur plus jeune âge.

© Palash Jain / Unsplash
« Mon père avec qui je me suis disputé est venu dans ma chambre et m’a frappé une vingtaine de fois avec sa ceinture. Il ne supporte pas que je sois gay et m’a viré de mon foyer. Étant à la rue, j’ai déposé plainte. » Ce témoignage est écrit par un enfant de moins de 15 ans. Il fait partie des 177 signalements que l’application FLAG!, du nom de l’association de sensibilisation à l’égalité des personnes LGBT+, a reçus depuis sa création en 2020.
Dans son dernier rapport sur le manque criant de protection des mineurs LGBTI+, l’Observatoire LGBTI+ de la Fondation Jean Jaurès a voulu montrer la manière dont les violences LGBTIphobes s’exercent dans chaque espace de socialisation. Sur la base des signalements reçus par FLAG!, Flora Bolter, codirectrice de cet Observatoire, constate que les discriminations s’exercent dans le cercle familial, à l’école, en ligne ou dans la rue. « Ne pas dire cette réalité, c’est faire la sourde oreille aux appels à l’aide des enfants de tous âges qui témoignent de ce qui leur arrive et cherchent désespérément une écoute et une aide de celles et ceux qui sont censés participer à leur protection », explique-t-elle, en ce 17 mai de Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie.
Le cadre scolaire est le cadre le plus insécurisant
Dans une étude spécifiquement axée sur les victimes mineures de violences LGBTIphobes, Flora Bolter pointe notamment le rôle de l’école. Elle rappelle que selon l’enquête menée par l’Ifop pour la Fondation Jasmin Roy, en 2019, « 28 % des personnes LGBT interrogées confient avoir été victimes de discrimination au moins une fois au cours des sur vie de la part d’élèves ou d’étudiants dans un établissement scolaire ». Des discriminations qui viennent aussi d’adultes : « 19 % ont vécu des mêmes discriminations de la part d’enseignants au cours de leurs parcours scolaire », faisant du cadre scolaire « de loin le plus insécurisant ».
La codirectrice rappelle également que plus de 60 % des enfants LGBT et 82 % des enfants trans ou intersexes ont une « expérience scolaire négative du fait de leur orientation sexuelle, des leur identité de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles », d’après l’enquête « Santé des élèves LGBTI » menée par Johanna Dagorn et Arnaud Alessandrin, en 2018.
Dans les signalements reçus par FLAG!, que la Fondation Jean Jaurès a examinés, l’école est le lieu qui représente près d’un tiers des violences subies. Il constitue ainsi un véritable « espace de victimisation », dans lequel les auteurs des faits peuvent être « des élèves, des camarades de classe, des enseignants un autre personnel scolaire ». Ainsi en est-il de cette fille de moins de 15 ans qui écrit, en 2023, un signalement où elle raconte : « J’étais à la même table que lui et il m’a dit ‘Dégage sale lesbienne’ ou encore ‘Monsieur, je veux pas d’elle !’ envers un adulte de l’établissement. »
Lancées en groupe ou individuellement, ces « microviolences répétées » renvoient l’enfant vers une solitude extrême, qui peut parfois le pousser à tenter de mettre fin à ses jours. Cet isolement total est renforcé lorsque s’ajoutent aux violences « la peur de parler de cela à ses parents, l’absence de soutien à attendre de la famille, voire l’écho ou le paroxysme de ces violences dans le cadre familial ».
« Mon père m’a frappé »
D’après l’étude des signalements reçus par FLAG!, la famille représente le deuxième espace de victimisation après l’école (9 % des témoignages). Les questions répétitives, le rejet, l’exclusion voire les violences commises par un ou des membres de la famille à l’encontre de leur enfant LGBTI peuvent mener à des situations dramatiques. Ainsi, dans l’enquête « Violence et rapports de genre », Mathieu Trachmann et Tania Lejbowicz montrent que les personnes LGBT sont « nettement plus nombreuses » que dans la population générale « à avoir quitté le domicile parental pour raison de conflit ». Ces personnes, qui peuvent être mineures, sont surexposées aux « situations de rue ou de ‘débrouille’ et aux risques associés ».
Mon père m’a frappé de plusieurs coups de poing lorsqu’il a découvert que j’étais bi et que mon copain est venu à la maison.
Parmi les témoignages reçus, plusieurs évoquent de la violence « qui peut aller de la violence physique » aux « thérapies de conversion, voire à l’empoisonnement ou la tentative de meurtre ». Comme pour ce jeune entre 16 et 18 ans, qui écrit en 2022 : « Mon père m’a frappé de plusieurs coups de poing lorsqu’il a découvert que j’étais bi et que mon copain est venu à la maison. Il m’a ensuite viré de chez moi et je me suis retrouvé à la rue. »
Politisation de la transphobie
Dans son rapport annuel, SOS Homophobie pointe notamment la recrudescence de la haine en ligne. « Les discours LGBTIphobes et complotistes s’intensifient sur Internet et le harcèlement sur les réseaux sociaux cible particulièrement les jeunes LGBTI », indique le document. Sur les 2 377 des cas recensés par SOS Homophobie, 23 % concernent des faits de discrimination sur Internet.
Cette part importante interpelle l’association pour « la troisième année consécutive ». Elle l’impute, en outre, au « changement de direction de Twitter, devenu X, [qui] a notamment vu une baisse significative de la modération, permettant la prolifération de discours haineux. » Des vagues violentes s’abattent sur des anonymes ou des personnalités publiques, comme lors de la nomination de Gabriel Attal au ministère de l’Éducation nationale, en juillet, ou au concert de Bilal Hassani dans une église désacralisée, cite, par exemple, SOS Homophobie.
Des discours qui sont légitimés par des politiques ou des structures d’extrême droite, à l’instar de « Parents vigilants », issu du parti Reconquête fondé par Éric Zemmour. Un mouvement « inspiré de modèles conservateurs américains, illustre la politisation de la transphobie et de l’homophobie, utilisant les réseaux sociaux pour exercer une pression sur le système éducatif et promouvoir une idéologie LGBTIphobe. »
Mais aussi par des propositions de loi transphobes, comme celle avancée par les Républicains sur l’interdiction des transitions pour les mineurs, à laquelle 1 000 professionnels en psychologie s’opposaient dans Politis. Ou bien des publications, comme le livre de Doria Moutot et Marguerite Stern, reprises à l’envi dans les médias réactionnaires.
Un climat de rejet qui hisse la transophobie à la deuxième place des sujets de préoccupation des témoignages reçus par SOS Homophobie (21 %), après la gayphobie (45 %). « Ces cas émanent principalement de jeunes victimes (13 % ont moins de 18 ans et plus d’un quart ont entre 18 ans et 34 ans) », précise SOS Homophobie, qui tient à rappeler : « la transphobie tue, menace l’intégrité et la santé, précarise et exclut les personnes trans. »
Solitude dans un environnement hostile
L’autre espace de violences LGBTIphobes n’est pas ni à l’école, ni auprès des proches, ou sur les réseaux sociaux : c’est en pleine rue, avec le phénomène des guets-apens. Ces rendez-vous, prétendument organisés pour des relations sexuelles, finissent par un déchaînement de violence comme le montre le récent documentaire de Mediapart, « Guet-apens, des crimes invisibles ». Le média d’investigation en comptait au moins 300 entre 2017 et 2021, avec pas moins de 122 victimes rien qu’en 2022.
C’est « une agression tous les trois jours », rappelle le second rapport de l’Observatoire LGBTI+ de la Fondation Jean Jaurès dédié à cette question. Son autrice, Flora Bolter, identifie un scénario assez similaire pour chaque victime : « Une personne est ciblée, ostensiblement dans l’optique d’une rencontre sexuelle, par une personne qui ne lui est pas connue, sur un lieu de drague ou par le biais d’un site (de rencontre le plus souvent). Une fois à l’écart, la personne non connue commence à frapper ou menacer, au besoin en se faisant rejoindre par des complices. »
En analysant les signalements en ce sens reçus par FLAG!, Flora Bolter constate une « impression de solitude : solitude dans un environnement hostile, solitude quand on est isolé chez soi ou dans un lieu à l’écart, et solitude dans la réponse à l’acte ».
Pour aller plus loin…

Mobilisations étudiantes pour Gaza : « Un véritable tournant répressif »

« L’inceste, c’est toute une vie de silence »
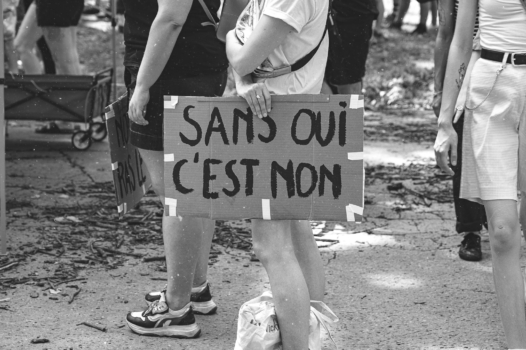
Violences sexistes et sexuelles : pour prolonger notre numéro spécial